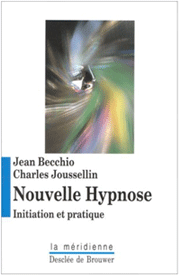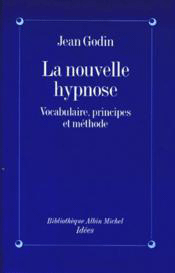Hypnothérapeutes à Paris, ils vous donnent leur avis au sujet de l'hypnose, de l'EMDR, des formations en hypnose médicale
Mis à jour : il y a 12 heures 11 min
Formations EMDR: le premier comparatif structuré.
France EMDR - IMO ®, dont je suis le Vice Président, a le plaisir d’annoncer, avec une joie non dissimulée, la parution du tableau comparatif des formations EMDR en France. Un document indépendant, clair et structuré… qui met enfin en lumière la diversité du paysage, la qualité des approches, et le sérieux des institutions réellement engagées dans la formation. Nous sommes particulièrement heureux d’y voir reconnue l’approche EMDR Intégrative, portée par des professionnels de santé et fondée sur des bases scientifiques solides.
Depuis longtemps, les professionnels de la psychothérapie, les hypnothérapeutes attendaient un panorama fiable des formations EMDR disponibles en France. Ce travail de comparaison offre enfin une vision structurée et lisible d’un univers où s’entremêlent une multitude de méthodes, d’intitulés et d’écoles, parfois au point de perdre les praticiens les plus aguerris.
Comme dans le milieu de l’hypnose, l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) s’est développée à travers des organismes très sérieux… et d’autres beaucoup plus discutables, hélas.
Face aux approches validées cohabitent des déclinaisons parallèles, des adaptations personnelles ou des versions simplifiées dont les noms remplissent à eux seuls des pages entières : DMOKA ®, DNR ®, EMDR-AC ®, EMDR-DSA ®, EMDR - IMO ®, EMDR-RSB ®, EMDR-DMO ®, EMDR-PE.PS ®, RITMO ®, Thérapie MOSAIC ®, ou encore IMO (Intégration par les Mouvements Oculaires). Un véritable foisonnement qui rendait urgent un outil de comparaison impartial.
Chaque sigle renvoie d’ailleurs à une vision particulière de l’accompagnement thérapeutique : certaines restent proches du modèle élaboré par Francine Shapiro, d’autres en prennent des libertés plus ou moins assumées.
Le tableau met ainsi en lumière les différences essentielles : nature du protocole, qualité pédagogique, et surtout compétences réelles en santé mentale des équipes enseignantes. Un critère déterminant pour garantir une formation solide.
Ce panorama recense les acteurs incontournables du territoire : ACCH, AFPRA, AHTMA, CAP au 180, CHTIP – Collège d’Hypnose et Thérapies Intégratives de Paris, EDEPHE, EMDR France, France EMDR-IMO, EPSYLONE, HARMONESIS, HYPNOSALYS, IFEMDR, Institut Hypnotim Marseille, Institut IN-DOLORE, PÔLE EMDR, PSYNAPSE, SENSALYS, SYMBIOFI et IPNOSIA.
A partir des instituts de base EMDR France, certaines structures se démarquent par une orientation clairement intégrative de l’EMDR. C’est le cas de France EMDR-IMO (dont je suis Vice Président, et fier aussi d'avoir été si bien classé), qui s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes) et propose une lecture élargie des mouvements oculaires, combinant neurosciences, hypnose et communication thérapeutique. Une approche connue sous le nom d’EMDR Intégrative, pensée pour replacer la personne au centre du processus thérapeutique.
Plus qu’un simple tableau comparatif, ce document offre une clarification indispensable dans un secteur en plein essor. Il rappelle que la qualité d’une formation conditionne directement la qualité de l’accompagnement proposé aux patients. Pour les praticiens comme pour les professionnels de santé en recherche d’une formation, il représente une étape importante : celle d’un regard enfin structuré et éclairé sur l’ensemble des pratiques EMDR en France.
Accédez au tableau complet des formations en cliquant ici…
Comme dans le milieu de l’hypnose, l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) s’est développée à travers des organismes très sérieux… et d’autres beaucoup plus discutables, hélas.
Face aux approches validées cohabitent des déclinaisons parallèles, des adaptations personnelles ou des versions simplifiées dont les noms remplissent à eux seuls des pages entières : DMOKA ®, DNR ®, EMDR-AC ®, EMDR-DSA ®, EMDR - IMO ®, EMDR-RSB ®, EMDR-DMO ®, EMDR-PE.PS ®, RITMO ®, Thérapie MOSAIC ®, ou encore IMO (Intégration par les Mouvements Oculaires). Un véritable foisonnement qui rendait urgent un outil de comparaison impartial.
Chaque sigle renvoie d’ailleurs à une vision particulière de l’accompagnement thérapeutique : certaines restent proches du modèle élaboré par Francine Shapiro, d’autres en prennent des libertés plus ou moins assumées.
Le tableau met ainsi en lumière les différences essentielles : nature du protocole, qualité pédagogique, et surtout compétences réelles en santé mentale des équipes enseignantes. Un critère déterminant pour garantir une formation solide.
Ce panorama recense les acteurs incontournables du territoire : ACCH, AFPRA, AHTMA, CAP au 180, CHTIP – Collège d’Hypnose et Thérapies Intégratives de Paris, EDEPHE, EMDR France, France EMDR-IMO, EPSYLONE, HARMONESIS, HYPNOSALYS, IFEMDR, Institut Hypnotim Marseille, Institut IN-DOLORE, PÔLE EMDR, PSYNAPSE, SENSALYS, SYMBIOFI et IPNOSIA.
A partir des instituts de base EMDR France, certaines structures se démarquent par une orientation clairement intégrative de l’EMDR. C’est le cas de France EMDR-IMO (dont je suis Vice Président, et fier aussi d'avoir été si bien classé), qui s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes) et propose une lecture élargie des mouvements oculaires, combinant neurosciences, hypnose et communication thérapeutique. Une approche connue sous le nom d’EMDR Intégrative, pensée pour replacer la personne au centre du processus thérapeutique.
Plus qu’un simple tableau comparatif, ce document offre une clarification indispensable dans un secteur en plein essor. Il rappelle que la qualité d’une formation conditionne directement la qualité de l’accompagnement proposé aux patients. Pour les praticiens comme pour les professionnels de santé en recherche d’une formation, il représente une étape importante : celle d’un regard enfin structuré et éclairé sur l’ensemble des pratiques EMDR en France.
Accédez au tableau complet des formations en cliquant ici…
Catégories: Hypnose Paris,EMDR,Thérapie Brève Paris
Formations EMDR: le premier comparatif structuré.
France EMDR - IMO ®, dont je suis le Vice Président, a le plaisir d’annoncer, avec une joie non dissimulée, la parution du tableau comparatif des formations EMDR en France. Un document indépendant, clair et structuré… qui met enfin en lumière la diversité du paysage, la qualité des approches, et le sérieux des institutions réellement engagées dans la formation. Nous sommes particulièrement heureux d’y voir reconnue l’approche EMDR Intégrative, portée par des professionnels de santé et fondée sur des bases scientifiques solides.
Depuis longtemps, les professionnels de la psychothérapie, les hypnothérapeutes attendaient un panorama fiable des formations EMDR disponibles en France. Ce travail de comparaison offre enfin une vision structurée et lisible d’un univers où s’entremêlent une multitude de méthodes, d’intitulés et d’écoles, parfois au point de perdre les praticiens les plus aguerris.
Comme dans le milieu de l’hypnose, l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) s’est développée à travers des organismes très sérieux… et d’autres beaucoup plus discutables, hélas.
Face aux approches validées cohabitent des déclinaisons parallèles, des adaptations personnelles ou des versions simplifiées dont les noms remplissent à eux seuls des pages entières : DMOKA ®, DNR ®, EMDR-AC ®, EMDR-DSA ®, EMDR - IMO ®, EMDR-RSB ®, EMDR-DMO ®, EMDR-PE.PS ®, RITMO ®, Thérapie MOSAIC ®, ou encore IMO (Intégration par les Mouvements Oculaires). Un véritable foisonnement qui rendait urgent un outil de comparaison impartial.
Chaque sigle renvoie d’ailleurs à une vision particulière de l’accompagnement thérapeutique : certaines restent proches du modèle élaboré par Francine Shapiro, d’autres en prennent des libertés plus ou moins assumées.
Le tableau met ainsi en lumière les différences essentielles : nature du protocole, qualité pédagogique, et surtout compétences réelles en santé mentale des équipes enseignantes. Un critère déterminant pour garantir une formation solide.
Ce panorama recense les acteurs incontournables du territoire : ACCH, AFPRA, AHTMA, CAP au 180, CHTIP – Collège d’Hypnose et Thérapies Intégratives de Paris, EDEPHE, EMDR France, France EMDR-IMO, EPSYLONE, HARMONESIS, HYPNOSALYS, IFEMDR, Institut Hypnotim Marseille, Institut IN-DOLORE, PÔLE EMDR, PSYNAPSE, SENSALYS, SYMBIOFI et IPNOSIA.
A partir des instituts de base EMDR France, certaines structures se démarquent par une orientation clairement intégrative de l’EMDR. C’est le cas de France EMDR-IMO (dont je suis Vice Président, et fier aussi d'avoir été si bien classé), qui s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes) et propose une lecture élargie des mouvements oculaires, combinant neurosciences, hypnose et communication thérapeutique. Une approche connue sous le nom d’EMDR Intégrative, pensée pour replacer la personne au centre du processus thérapeutique.
Plus qu’un simple tableau comparatif, ce document offre une clarification indispensable dans un secteur en plein essor. Il rappelle que la qualité d’une formation conditionne directement la qualité de l’accompagnement proposé aux patients. Pour les praticiens comme pour les professionnels de santé en recherche d’une formation, il représente une étape importante : celle d’un regard enfin structuré et éclairé sur l’ensemble des pratiques EMDR en France.
Accédez au tableau complet des formations en cliquant ici…
Comme dans le milieu de l’hypnose, l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) s’est développée à travers des organismes très sérieux… et d’autres beaucoup plus discutables, hélas.
Face aux approches validées cohabitent des déclinaisons parallèles, des adaptations personnelles ou des versions simplifiées dont les noms remplissent à eux seuls des pages entières : DMOKA ®, DNR ®, EMDR-AC ®, EMDR-DSA ®, EMDR - IMO ®, EMDR-RSB ®, EMDR-DMO ®, EMDR-PE.PS ®, RITMO ®, Thérapie MOSAIC ®, ou encore IMO (Intégration par les Mouvements Oculaires). Un véritable foisonnement qui rendait urgent un outil de comparaison impartial.
Chaque sigle renvoie d’ailleurs à une vision particulière de l’accompagnement thérapeutique : certaines restent proches du modèle élaboré par Francine Shapiro, d’autres en prennent des libertés plus ou moins assumées.
Le tableau met ainsi en lumière les différences essentielles : nature du protocole, qualité pédagogique, et surtout compétences réelles en santé mentale des équipes enseignantes. Un critère déterminant pour garantir une formation solide.
Ce panorama recense les acteurs incontournables du territoire : ACCH, AFPRA, AHTMA, CAP au 180, CHTIP – Collège d’Hypnose et Thérapies Intégratives de Paris, EDEPHE, EMDR France, France EMDR-IMO, EPSYLONE, HARMONESIS, HYPNOSALYS, IFEMDR, Institut Hypnotim Marseille, Institut IN-DOLORE, PÔLE EMDR, PSYNAPSE, SENSALYS, SYMBIOFI et IPNOSIA.
A partir des instituts de base EMDR France, certaines structures se démarquent par une orientation clairement intégrative de l’EMDR. C’est le cas de France EMDR-IMO (dont je suis Vice Président, et fier aussi d'avoir été si bien classé), qui s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes) et propose une lecture élargie des mouvements oculaires, combinant neurosciences, hypnose et communication thérapeutique. Une approche connue sous le nom d’EMDR Intégrative, pensée pour replacer la personne au centre du processus thérapeutique.
Plus qu’un simple tableau comparatif, ce document offre une clarification indispensable dans un secteur en plein essor. Il rappelle que la qualité d’une formation conditionne directement la qualité de l’accompagnement proposé aux patients. Pour les praticiens comme pour les professionnels de santé en recherche d’une formation, il représente une étape importante : celle d’un regard enfin structuré et éclairé sur l’ensemble des pratiques EMDR en France.
Accédez au tableau complet des formations en cliquant ici…
Catégories: Hypnose Paris,EMDR,Thérapie Brève Paris