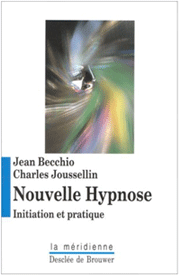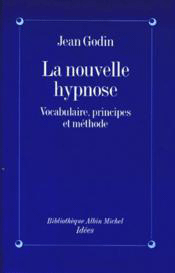EMDR: Comprendre l’oubli traumatique : pourquoi la mémoire s’efface… et pourquoi elle revient.
Lorsqu’une personne traverse un événement potentiellement traumatique (agression sexuelle, accident, violences psychologiques, menace vitale), elle s’attend souvent à garder un souvenir précis de ce qui s’est produit. Pourtant, de nombreuses victimes témoignent d’une expérience déroutante : une impossibilité de se rappeler l’ensemble de la scène, une mémoire qui se fragmente, ou un récit impossible à reconstituer.
Ce phénomène, longtemps mal compris, est aujourd’hui considéré comme l’un des marqueurs du stress post-traumatique. Il ne traduit pas une faiblesse psychologique : c’est une stratégie de survie du cerveau.
Quand le traumatisme bouleverse les systèmes de mémoire.
Les neurosciences nous montrent que deux formes de mémoire réagissent différemment face au choc :
1. La mémoire émotionnelle, suractivée.
Cette mémoire enregistre tout ce qui peut représenter un danger : une odeur, un contact physique, un bruit soudain, une expression du visage, le sentiment de terreur ou d’impuissance.
Ces informations sensorielles sont mémorisées avec une intensité inhabituelle, presque comme si elles étaient gravées, gravées à vif. On parle aussi de “surencodage émotionnel”.
2. La mémoire autobiographique, désactivée.
À l’inverse, la mémoire qui organise un récit cohérent (avec un début, un déroulement et une fin), peut se couper brutalement.
Le cerveau, qui est alors saturé par l’adrénaline et le cortisol, ne parvient plus à structurer l’expérience.
L’événement ne devient donc pas un souvenir classique : il reste un ensemble de fragments, d’impressions brutes, sans fil conducteur. Cette déconnexion correspond au phénomène de dissociation, bien connu dans les traumas complexes.
L’oubli traumatique : une protection qui devient un piège.
Cet oubli apparent protège temporairement la personne. Mais il ne résout rien.
Ce qui n’a pas été digéré psychiquement va continuer à agir en arrière-plan : des flashbacks soudains, des cauchemars récurrents, de l'hypervigilance, des réactions disproportionnées à des stimuli mineurs, de l'anxiété diffuse, des troubles du sommeil, un malaise associé à une odeur ou une ambiance sonore.
L’oubli n’est pas une guérison. C’est juste une pause.
Ce qui n’a pas été intégré cherche à revenir, parfois même des années plus tard.
Comment l’EMDR Intégrative (EMDR–IMO) aide à réorganiser la mémoire traumatique ?
L'une des approches les plus étudiées et utilisées aujourd’hui dans le traitement des traumatismes est la thérapie EMDR Intégrative, qui combine la pratique EMDR classique et l’IMO (Intégration par les Mouvements Oculaires).
Cette approche élargie appartient à la famille des thérapies dites de retraitement, qui visent à aider le cerveau à refaire son travail d’intégration émotionnelle.
Elle repose sur l’alternance de stimulations bilatérales alternées, permettant d’activer les deux hémisphères cérébraux.
Alors, quels sont les objectifs de l'approche en EMDR Intégrative ?
Le travail n’efface pas le souvenir, mais il transforme la manière dont il est vécu.
Pourquoi l’EMDR Intégrative est particulièrement pertinente dans les traumas complexes ?
Les traumatismes liés aux abus sexuels, aux violences répétées ou à des événements non racontables, créent souvent des mémoires en morceaux, difficiles voir impossibles à raconter.
Et l’approche EMDR-IMO va permetre précisément :
Au fil des consultations, beaucoup de patients décrivent un apaisement progressif et rapide: l’image s’éloigne, le corps qui se détend plus, l’émotion qui s’adoucit. Les pièces du puzzle se remettent en place, non pour revivre le passé, mais pour pouvoir enfin en ressortir.
« Reprendre le fil de son histoire » : un processus thérapeutique guidé et sécurisé.
Dans le cadre d’une thérapie EMDR Intégrative, la reconstruction ne se fait jamais dans la précipitation.
Le praticien crée d’abord un espace sécurisé, un lieu intérieur stable, pour permettre à la personne de revisiter l’événement sans se sentir submergée, et surtout un LIEN Sécure.
Le retraitement s’effectue ensuite par étapes, avec un rythme adapté.
C’est au cœur de ce processus que la mémoire autobiographique peut se réactiver, retrouvant une cohérence qu’elle avait perdue.
La personne ne reste plus spectatrice du trauma mais elle redevient actrice de son histoire.
Une démarche thérapeutique accessible à tout moment de la vie.
Certaines personnes consultent peu après les faits.
D’autres entreprennent ce travail vingt ou trente ans plus tard. Ce qui compte, ce n’est pas la date du traumatisme : c'est son retentissement actuel.
L’EMDR Intégrative est donc une approche brève dans sa structure, mais profonde dans ses effets. Elle peut accompagner les adultes, les adolescents, et dans certains cadres adaptés, les enfants.
Cabinet d'EMDR Intégrative
41, rue Oberkampf
75011 Paris
Tel: 01.43.55.11.66
Ce phénomène, longtemps mal compris, est aujourd’hui considéré comme l’un des marqueurs du stress post-traumatique. Il ne traduit pas une faiblesse psychologique : c’est une stratégie de survie du cerveau.
Quand le traumatisme bouleverse les systèmes de mémoire.
Les neurosciences nous montrent que deux formes de mémoire réagissent différemment face au choc :
1. La mémoire émotionnelle, suractivée.
Cette mémoire enregistre tout ce qui peut représenter un danger : une odeur, un contact physique, un bruit soudain, une expression du visage, le sentiment de terreur ou d’impuissance.
Ces informations sensorielles sont mémorisées avec une intensité inhabituelle, presque comme si elles étaient gravées, gravées à vif. On parle aussi de “surencodage émotionnel”.
2. La mémoire autobiographique, désactivée.
À l’inverse, la mémoire qui organise un récit cohérent (avec un début, un déroulement et une fin), peut se couper brutalement.
Le cerveau, qui est alors saturé par l’adrénaline et le cortisol, ne parvient plus à structurer l’expérience.
L’événement ne devient donc pas un souvenir classique : il reste un ensemble de fragments, d’impressions brutes, sans fil conducteur. Cette déconnexion correspond au phénomène de dissociation, bien connu dans les traumas complexes.
L’oubli traumatique : une protection qui devient un piège.
Cet oubli apparent protège temporairement la personne. Mais il ne résout rien.
Ce qui n’a pas été digéré psychiquement va continuer à agir en arrière-plan : des flashbacks soudains, des cauchemars récurrents, de l'hypervigilance, des réactions disproportionnées à des stimuli mineurs, de l'anxiété diffuse, des troubles du sommeil, un malaise associé à une odeur ou une ambiance sonore.
L’oubli n’est pas une guérison. C’est juste une pause.
Ce qui n’a pas été intégré cherche à revenir, parfois même des années plus tard.
Comment l’EMDR Intégrative (EMDR–IMO) aide à réorganiser la mémoire traumatique ?
L'une des approches les plus étudiées et utilisées aujourd’hui dans le traitement des traumatismes est la thérapie EMDR Intégrative, qui combine la pratique EMDR classique et l’IMO (Intégration par les Mouvements Oculaires).
Cette approche élargie appartient à la famille des thérapies dites de retraitement, qui visent à aider le cerveau à refaire son travail d’intégration émotionnelle.
Elle repose sur l’alternance de stimulations bilatérales alternées, permettant d’activer les deux hémisphères cérébraux.
Alors, quels sont les objectifs de l'approche en EMDR Intégrative ?
- rétablir le fil du récit personnel,
- désactiver la charge émotionnelle restée figée,
- reconnecter les sensations et les émotions à un cadre plus adapté,
- diminuer l’hyperréactivité du système d’alarme,
- permettre à la personne de se réapproprier son histoire.
Le travail n’efface pas le souvenir, mais il transforme la manière dont il est vécu.
Pourquoi l’EMDR Intégrative est particulièrement pertinente dans les traumas complexes ?
Les traumatismes liés aux abus sexuels, aux violences répétées ou à des événements non racontables, créent souvent des mémoires en morceaux, difficiles voir impossibles à raconter.
Et l’approche EMDR-IMO va permetre précisément :
- de réassocier ce qui s’est dissocié,
- d’intégrer les éléments sensoriels restés bruts,
- de diminuer les flashs et les reviviscences,
- de rendre l’événement “gérable” psychiquement.
Au fil des consultations, beaucoup de patients décrivent un apaisement progressif et rapide: l’image s’éloigne, le corps qui se détend plus, l’émotion qui s’adoucit. Les pièces du puzzle se remettent en place, non pour revivre le passé, mais pour pouvoir enfin en ressortir.
« Reprendre le fil de son histoire » : un processus thérapeutique guidé et sécurisé.
Dans le cadre d’une thérapie EMDR Intégrative, la reconstruction ne se fait jamais dans la précipitation.
Le praticien crée d’abord un espace sécurisé, un lieu intérieur stable, pour permettre à la personne de revisiter l’événement sans se sentir submergée, et surtout un LIEN Sécure.
Le retraitement s’effectue ensuite par étapes, avec un rythme adapté.
C’est au cœur de ce processus que la mémoire autobiographique peut se réactiver, retrouvant une cohérence qu’elle avait perdue.
La personne ne reste plus spectatrice du trauma mais elle redevient actrice de son histoire.
Une démarche thérapeutique accessible à tout moment de la vie.
Certaines personnes consultent peu après les faits.
D’autres entreprennent ce travail vingt ou trente ans plus tard. Ce qui compte, ce n’est pas la date du traumatisme : c'est son retentissement actuel.
L’EMDR Intégrative est donc une approche brève dans sa structure, mais profonde dans ses effets. Elle peut accompagner les adultes, les adolescents, et dans certains cadres adaptés, les enfants.
Cabinet d'EMDR Intégrative
41, rue Oberkampf
75011 Paris
Tel: 01.43.55.11.66
Catégories: Hypnose Paris,EMDR,Thérapie Brève Paris
EMDR: Comprendre l’oubli traumatique : pourquoi la mémoire s’efface… et pourquoi elle revient.
Lorsqu’une personne traverse un événement potentiellement traumatique (agression sexuelle, accident, violences psychologiques, menace vitale), elle s’attend souvent à garder un souvenir précis de ce qui s’est produit. Pourtant, de nombreuses victimes témoignent d’une expérience déroutante : une impossibilité de se rappeler l’ensemble de la scène, une mémoire qui se fragmente, ou un récit impossible à reconstituer.
Ce phénomène, longtemps mal compris, est aujourd’hui considéré comme l’un des marqueurs du stress post-traumatique. Il ne traduit pas une faiblesse psychologique : c’est une stratégie de survie du cerveau.
Quand le traumatisme bouleverse les systèmes de mémoire.
Les neurosciences nous montrent que deux formes de mémoire réagissent différemment face au choc :
1. La mémoire émotionnelle, suractivée.
Cette mémoire enregistre tout ce qui peut représenter un danger : une odeur, un contact physique, un bruit soudain, une expression du visage, le sentiment de terreur ou d’impuissance.
Ces informations sensorielles sont mémorisées avec une intensité inhabituelle, presque comme si elles étaient gravées, gravées à vif. On parle aussi de “surencodage émotionnel”.
2. La mémoire autobiographique, désactivée.
À l’inverse, la mémoire qui organise un récit cohérent (avec un début, un déroulement et une fin), peut se couper brutalement.
Le cerveau, qui est alors saturé par l’adrénaline et le cortisol, ne parvient plus à structurer l’expérience.
L’événement ne devient donc pas un souvenir classique : il reste un ensemble de fragments, d’impressions brutes, sans fil conducteur. Cette déconnexion correspond au phénomène de dissociation, bien connu dans les traumas complexes.
L’oubli traumatique : une protection qui devient un piège.
Cet oubli apparent protège temporairement la personne. Mais il ne résout rien.
Ce qui n’a pas été digéré psychiquement va continuer à agir en arrière-plan : des flashbacks soudains, des cauchemars récurrents, de l'hypervigilance, des réactions disproportionnées à des stimuli mineurs, de l'anxiété diffuse, des troubles du sommeil, un malaise associé à une odeur ou une ambiance sonore.
L’oubli n’est pas une guérison. C’est juste une pause.
Ce qui n’a pas été intégré cherche à revenir, parfois même des années plus tard.
Comment l’EMDR Intégrative (EMDR–IMO) aide à réorganiser la mémoire traumatique ?
L'une des approches les plus étudiées et utilisées aujourd’hui dans le traitement des traumatismes est la thérapie EMDR Intégrative, qui combine la pratique EMDR classique et l’IMO (Intégration par les Mouvements Oculaires).
Cette approche élargie appartient à la famille des thérapies dites de retraitement, qui visent à aider le cerveau à refaire son travail d’intégration émotionnelle.
Elle repose sur l’alternance de stimulations bilatérales alternées, permettant d’activer les deux hémisphères cérébraux.
Alors, quels sont les objectifs de l'approche en EMDR Intégrative ?
Le travail n’efface pas le souvenir, mais il transforme la manière dont il est vécu.
Pourquoi l’EMDR Intégrative est particulièrement pertinente dans les traumas complexes ?
Les traumatismes liés aux abus sexuels, aux violences répétées ou à des événements non racontables, créent souvent des mémoires en morceaux, difficiles voir impossibles à raconter.
Et l’approche EMDR-IMO va permetre précisément :
Au fil des consultations, beaucoup de patients décrivent un apaisement progressif et rapide: l’image s’éloigne, le corps qui se détend plus, l’émotion qui s’adoucit. Les pièces du puzzle se remettent en place, non pour revivre le passé, mais pour pouvoir enfin en ressortir.
« Reprendre le fil de son histoire » : un processus thérapeutique guidé et sécurisé.
Dans le cadre d’une thérapie EMDR Intégrative, la reconstruction ne se fait jamais dans la précipitation.
Le praticien crée d’abord un espace sécurisé, un lieu intérieur stable, pour permettre à la personne de revisiter l’événement sans se sentir submergée, et surtout un LIEN Sécure.
Le retraitement s’effectue ensuite par étapes, avec un rythme adapté.
C’est au cœur de ce processus que la mémoire autobiographique peut se réactiver, retrouvant une cohérence qu’elle avait perdue.
La personne ne reste plus spectatrice du trauma mais elle redevient actrice de son histoire.
Une démarche thérapeutique accessible à tout moment de la vie.
Certaines personnes consultent peu après les faits.
D’autres entreprennent ce travail vingt ou trente ans plus tard. Ce qui compte, ce n’est pas la date du traumatisme : c'est son retentissement actuel.
L’EMDR Intégrative est donc une approche brève dans sa structure, mais profonde dans ses effets. Elle peut accompagner les adultes, les adolescents, et dans certains cadres adaptés, les enfants.
Cabinet d'EMDR Intégrative
41, rue Oberkampf
75011 Paris
Tel: 01.43.55.11.66
Ce phénomène, longtemps mal compris, est aujourd’hui considéré comme l’un des marqueurs du stress post-traumatique. Il ne traduit pas une faiblesse psychologique : c’est une stratégie de survie du cerveau.
Quand le traumatisme bouleverse les systèmes de mémoire.
Les neurosciences nous montrent que deux formes de mémoire réagissent différemment face au choc :
1. La mémoire émotionnelle, suractivée.
Cette mémoire enregistre tout ce qui peut représenter un danger : une odeur, un contact physique, un bruit soudain, une expression du visage, le sentiment de terreur ou d’impuissance.
Ces informations sensorielles sont mémorisées avec une intensité inhabituelle, presque comme si elles étaient gravées, gravées à vif. On parle aussi de “surencodage émotionnel”.
2. La mémoire autobiographique, désactivée.
À l’inverse, la mémoire qui organise un récit cohérent (avec un début, un déroulement et une fin), peut se couper brutalement.
Le cerveau, qui est alors saturé par l’adrénaline et le cortisol, ne parvient plus à structurer l’expérience.
L’événement ne devient donc pas un souvenir classique : il reste un ensemble de fragments, d’impressions brutes, sans fil conducteur. Cette déconnexion correspond au phénomène de dissociation, bien connu dans les traumas complexes.
L’oubli traumatique : une protection qui devient un piège.
Cet oubli apparent protège temporairement la personne. Mais il ne résout rien.
Ce qui n’a pas été digéré psychiquement va continuer à agir en arrière-plan : des flashbacks soudains, des cauchemars récurrents, de l'hypervigilance, des réactions disproportionnées à des stimuli mineurs, de l'anxiété diffuse, des troubles du sommeil, un malaise associé à une odeur ou une ambiance sonore.
L’oubli n’est pas une guérison. C’est juste une pause.
Ce qui n’a pas été intégré cherche à revenir, parfois même des années plus tard.
Comment l’EMDR Intégrative (EMDR–IMO) aide à réorganiser la mémoire traumatique ?
L'une des approches les plus étudiées et utilisées aujourd’hui dans le traitement des traumatismes est la thérapie EMDR Intégrative, qui combine la pratique EMDR classique et l’IMO (Intégration par les Mouvements Oculaires).
Cette approche élargie appartient à la famille des thérapies dites de retraitement, qui visent à aider le cerveau à refaire son travail d’intégration émotionnelle.
Elle repose sur l’alternance de stimulations bilatérales alternées, permettant d’activer les deux hémisphères cérébraux.
Alors, quels sont les objectifs de l'approche en EMDR Intégrative ?
- rétablir le fil du récit personnel,
- désactiver la charge émotionnelle restée figée,
- reconnecter les sensations et les émotions à un cadre plus adapté,
- diminuer l’hyperréactivité du système d’alarme,
- permettre à la personne de se réapproprier son histoire.
Le travail n’efface pas le souvenir, mais il transforme la manière dont il est vécu.
Pourquoi l’EMDR Intégrative est particulièrement pertinente dans les traumas complexes ?
Les traumatismes liés aux abus sexuels, aux violences répétées ou à des événements non racontables, créent souvent des mémoires en morceaux, difficiles voir impossibles à raconter.
Et l’approche EMDR-IMO va permetre précisément :
- de réassocier ce qui s’est dissocié,
- d’intégrer les éléments sensoriels restés bruts,
- de diminuer les flashs et les reviviscences,
- de rendre l’événement “gérable” psychiquement.
Au fil des consultations, beaucoup de patients décrivent un apaisement progressif et rapide: l’image s’éloigne, le corps qui se détend plus, l’émotion qui s’adoucit. Les pièces du puzzle se remettent en place, non pour revivre le passé, mais pour pouvoir enfin en ressortir.
« Reprendre le fil de son histoire » : un processus thérapeutique guidé et sécurisé.
Dans le cadre d’une thérapie EMDR Intégrative, la reconstruction ne se fait jamais dans la précipitation.
Le praticien crée d’abord un espace sécurisé, un lieu intérieur stable, pour permettre à la personne de revisiter l’événement sans se sentir submergée, et surtout un LIEN Sécure.
Le retraitement s’effectue ensuite par étapes, avec un rythme adapté.
C’est au cœur de ce processus que la mémoire autobiographique peut se réactiver, retrouvant une cohérence qu’elle avait perdue.
La personne ne reste plus spectatrice du trauma mais elle redevient actrice de son histoire.
Une démarche thérapeutique accessible à tout moment de la vie.
Certaines personnes consultent peu après les faits.
D’autres entreprennent ce travail vingt ou trente ans plus tard. Ce qui compte, ce n’est pas la date du traumatisme : c'est son retentissement actuel.
L’EMDR Intégrative est donc une approche brève dans sa structure, mais profonde dans ses effets. Elle peut accompagner les adultes, les adolescents, et dans certains cadres adaptés, les enfants.
Cabinet d'EMDR Intégrative
41, rue Oberkampf
75011 Paris
Tel: 01.43.55.11.66
Catégories: Hypnose Paris,EMDR,Thérapie Brève Paris
BRAINSPOTTING: trouver le point oculaire qui apaise.
Par Clotilde Hennequin-Rivoire, psychologue clinicienne, formée par David Grand, praticienne Brainspotting, thérapeute EMDR accréditée EMDR France.
Il y a des douleurs qui ne demandent pas à être expliquées.
Elles demandent à être localisées, à être trouvées, quelque part dans l’espace, ou dans un regard qui ne bouge plus.
Dans cet article, Clotilde Hennequin-Rivoire nous parle du Brainspotting comme d’une rencontre silencieuse entre un œil et une mémoire, un peu comme en EMDR et EMDR - IMO...
Une rencontre où le thérapeute n’impose rien, ne dirige rien, ne guérit rien. il trouve, il attend, il accompagne.
Le reste, c’est le corps qui le fait.
L’œil comme boussole du trauma.
La théorie est simple et presque désarmante de simplicité:
il existe un point dans le champ visuel où le système nerveux révèle spontanément l’endroit exact où le trauma est logé. Un point minuscule. Un angle de regard. Une micro-déviation.
Quelque chose comme un frémissement des paupières, une respiration suspendue, un arrêt du cou, une émotion qui monte d’un coup.
Ce point, le brainspot, est la porte d’accès à la charge traumatique.
David Grand, qui l’a découvert presque par accident, nous dit que le cerveau “parle” à travers le regard, qu’il montre où il a été blessé, où il s’est figé, où il attend réparation.
Clotilde Hennequin-Rivoire, quant à elle, en témoigne avec la précision d’une clinicienne et la sensibilité d’une poète.
Quand les mots ne suffisent plus.
Les patients arrivent avec des histoires lourdes : des agressions, des violences familiales, des accidents, des humiliations, des traumas complexes, des émotions incohérentes, des souvenirs fragmentés.
Parfois ils ne savent même pas pourquoi ils vont mal. Ils sentent juste que quelque chose les tire vers le bas.
Alors elle leur demande de suivre un mouvement lent, imperceptible de sa main, ou parfois un simple stylo, jusqu’à ce que quelque chose accroche: une pupille qui se bloque , un souffle qui change, ene larme qui se forme, un frisson, un effondrement ou même un sourire brutal.
Là, dans cette minuscule rencontre oculaire, quelque chose s’ouvre.
Rester là où ça tremble.
Le travail du Brainspotting est d’une simplicité déroutante :
on reste, on ne bouge pas, on maintient le regard, on laisse l’émotion prendre sa place, on permet au système nerveux de réorganiser ce qu’il avait figé.
Le thérapeute ne commente pas, ni ne dirige et ne reformule pas.
Il contient, tout simplement. Il offre la présence stable que l’enfant blessé n’a jamais eue, la présence ferme que l’adulte traumatisé ne trouve plus.
Et les patients peuvent explorent alors :
des tremblements, des vagues de chaleur, des tensions cervicales, des souvenirs flous, des images brèves, des sensations archaïques.
Et parfois, rien ne vient...
Mais “rien” en Brainspotting est déjà une information : c'est alors que le système se réorganise en profondeur, en silence.
Quand la charge se dissout.
Un moment arrive, toujours différent, où le corps fait un mouvement spontané : une expiration plus longue, un relâchement des épaules, une bascule de tête, un micro-sourire.
Bref, la charge traumatique se défait.
Sans qu’on ait eu besoin de la raconter, sans qu’on l’ait disséquée, sans qu’on ait même compris.
Le cerveau, livré à lui-même, va retrouver son chemin de réparation.
Le regard comme ancrage du monde intérieur.
Ce qu’Hennequin-Rivoire raconte avec le plus de délicatesse, c’est ce geste final : quand le patient détourne enfin les yeux, c’est comme si le monde revenait tout entier, le regard redevient mobile le présent redevient accessible, la connexion à soi circule de nouveau.
Le Brainspotting est donc une approche où les mots viennent après, un peu comme dans certaines approches en EMDR IMO...
Où le sens vient après, où la compréhension vient après.
Parce que le trauma n’est pas un problème à analyser, mais une charge à libérer.
Et parfois, pour guérir, il suffit d’un point, un minuscule point dans le regard, juste trouvé au bon moment, et accueilli avec la bonne présence...Et tenu jusqu’à ce que la vie recommence enfin à circuler.
Lire l'article dans son intégralité... Commandez le Hors-Série 18 de la Revue Hypnose & Thérapies Brèves sur le Psychotraumatisme en cliquant sur ce lien
Crédit Photo © Xavier Montoy
Elles demandent à être localisées, à être trouvées, quelque part dans l’espace, ou dans un regard qui ne bouge plus.
Dans cet article, Clotilde Hennequin-Rivoire nous parle du Brainspotting comme d’une rencontre silencieuse entre un œil et une mémoire, un peu comme en EMDR et EMDR - IMO...
Une rencontre où le thérapeute n’impose rien, ne dirige rien, ne guérit rien. il trouve, il attend, il accompagne.
Le reste, c’est le corps qui le fait.
L’œil comme boussole du trauma.
La théorie est simple et presque désarmante de simplicité:
il existe un point dans le champ visuel où le système nerveux révèle spontanément l’endroit exact où le trauma est logé. Un point minuscule. Un angle de regard. Une micro-déviation.
Quelque chose comme un frémissement des paupières, une respiration suspendue, un arrêt du cou, une émotion qui monte d’un coup.
Ce point, le brainspot, est la porte d’accès à la charge traumatique.
David Grand, qui l’a découvert presque par accident, nous dit que le cerveau “parle” à travers le regard, qu’il montre où il a été blessé, où il s’est figé, où il attend réparation.
Clotilde Hennequin-Rivoire, quant à elle, en témoigne avec la précision d’une clinicienne et la sensibilité d’une poète.
Quand les mots ne suffisent plus.
Les patients arrivent avec des histoires lourdes : des agressions, des violences familiales, des accidents, des humiliations, des traumas complexes, des émotions incohérentes, des souvenirs fragmentés.
Parfois ils ne savent même pas pourquoi ils vont mal. Ils sentent juste que quelque chose les tire vers le bas.
Alors elle leur demande de suivre un mouvement lent, imperceptible de sa main, ou parfois un simple stylo, jusqu’à ce que quelque chose accroche: une pupille qui se bloque , un souffle qui change, ene larme qui se forme, un frisson, un effondrement ou même un sourire brutal.
Là, dans cette minuscule rencontre oculaire, quelque chose s’ouvre.
Rester là où ça tremble.
Le travail du Brainspotting est d’une simplicité déroutante :
on reste, on ne bouge pas, on maintient le regard, on laisse l’émotion prendre sa place, on permet au système nerveux de réorganiser ce qu’il avait figé.
Le thérapeute ne commente pas, ni ne dirige et ne reformule pas.
Il contient, tout simplement. Il offre la présence stable que l’enfant blessé n’a jamais eue, la présence ferme que l’adulte traumatisé ne trouve plus.
Et les patients peuvent explorent alors :
des tremblements, des vagues de chaleur, des tensions cervicales, des souvenirs flous, des images brèves, des sensations archaïques.
Et parfois, rien ne vient...
Mais “rien” en Brainspotting est déjà une information : c'est alors que le système se réorganise en profondeur, en silence.
Quand la charge se dissout.
Un moment arrive, toujours différent, où le corps fait un mouvement spontané : une expiration plus longue, un relâchement des épaules, une bascule de tête, un micro-sourire.
Bref, la charge traumatique se défait.
Sans qu’on ait eu besoin de la raconter, sans qu’on l’ait disséquée, sans qu’on ait même compris.
Le cerveau, livré à lui-même, va retrouver son chemin de réparation.
Le regard comme ancrage du monde intérieur.
Ce qu’Hennequin-Rivoire raconte avec le plus de délicatesse, c’est ce geste final : quand le patient détourne enfin les yeux, c’est comme si le monde revenait tout entier, le regard redevient mobile le présent redevient accessible, la connexion à soi circule de nouveau.
Le Brainspotting est donc une approche où les mots viennent après, un peu comme dans certaines approches en EMDR IMO...
Où le sens vient après, où la compréhension vient après.
Parce que le trauma n’est pas un problème à analyser, mais une charge à libérer.
Et parfois, pour guérir, il suffit d’un point, un minuscule point dans le regard, juste trouvé au bon moment, et accueilli avec la bonne présence...Et tenu jusqu’à ce que la vie recommence enfin à circuler.
Lire l'article dans son intégralité... Commandez le Hors-Série 18 de la Revue Hypnose & Thérapies Brèves sur le Psychotraumatisme en cliquant sur ce lien
Crédit Photo © Xavier Montoy
Catégories: Hypnose Paris,EMDR,Thérapie Brève Paris
BRAINSPOTTING: trouver le point oculaire qui apaise.
Par Clotilde Hennequin-Rivoire, psychologue clinicienne, formée par David Grand, praticienne Brainspotting, thérapeute EMDR accréditée EMDR France.
Il y a des douleurs qui ne demandent pas à être expliquées.
Elles demandent à être localisées, à être trouvées, quelque part dans l’espace, ou dans un regard qui ne bouge plus.
Dans cet article, Clotilde Hennequin-Rivoire nous parle du Brainspotting comme d’une rencontre silencieuse entre un œil et une mémoire, un peu comme en EMDR et EMDR - IMO...
Une rencontre où le thérapeute n’impose rien, ne dirige rien, ne guérit rien. il trouve, il attend, il accompagne.
Le reste, c’est le corps qui le fait.
L’œil comme boussole du trauma.
La théorie est simple et presque désarmante de simplicité:
il existe un point dans le champ visuel où le système nerveux révèle spontanément l’endroit exact où le trauma est logé. Un point minuscule. Un angle de regard. Une micro-déviation.
Quelque chose comme un frémissement des paupières, une respiration suspendue, un arrêt du cou, une émotion qui monte d’un coup.
Ce point, le brainspot, est la porte d’accès à la charge traumatique.
David Grand, qui l’a découvert presque par accident, nous dit que le cerveau “parle” à travers le regard, qu’il montre où il a été blessé, où il s’est figé, où il attend réparation.
Clotilde Hennequin-Rivoire, quant à elle, en témoigne avec la précision d’une clinicienne et la sensibilité d’une poète.
Quand les mots ne suffisent plus.
Les patients arrivent avec des histoires lourdes : des agressions, des violences familiales, des accidents, des humiliations, des traumas complexes, des émotions incohérentes, des souvenirs fragmentés.
Parfois ils ne savent même pas pourquoi ils vont mal. Ils sentent juste que quelque chose les tire vers le bas.
Alors elle leur demande de suivre un mouvement lent, imperceptible de sa main, ou parfois un simple stylo, jusqu’à ce que quelque chose accroche: une pupille qui se bloque , un souffle qui change, ene larme qui se forme, un frisson, un effondrement ou même un sourire brutal.
Là, dans cette minuscule rencontre oculaire, quelque chose s’ouvre.
Rester là où ça tremble.
Le travail du Brainspotting est d’une simplicité déroutante :
on reste, on ne bouge pas, on maintient le regard, on laisse l’émotion prendre sa place, on permet au système nerveux de réorganiser ce qu’il avait figé.
Le thérapeute ne commente pas, ni ne dirige et ne reformule pas.
Il contient, tout simplement. Il offre la présence stable que l’enfant blessé n’a jamais eue, la présence ferme que l’adulte traumatisé ne trouve plus.
Et les patients peuvent explorent alors :
des tremblements, des vagues de chaleur, des tensions cervicales, des souvenirs flous, des images brèves, des sensations archaïques.
Et parfois, rien ne vient...
Mais “rien” en Brainspotting est déjà une information : c'est alors que le système se réorganise en profondeur, en silence.
Quand la charge se dissout.
Un moment arrive, toujours différent, où le corps fait un mouvement spontané : une expiration plus longue, un relâchement des épaules, une bascule de tête, un micro-sourire.
Bref, la charge traumatique se défait.
Sans qu’on ait eu besoin de la raconter, sans qu’on l’ait disséquée, sans qu’on ait même compris.
Le cerveau, livré à lui-même, va retrouver son chemin de réparation.
Le regard comme ancrage du monde intérieur.
Ce qu’Hennequin-Rivoire raconte avec le plus de délicatesse, c’est ce geste final : quand le patient détourne enfin les yeux, c’est comme si le monde revenait tout entier, le regard redevient mobile le présent redevient accessible, la connexion à soi circule de nouveau.
Le Brainspotting est donc une approche où les mots viennent après, un peu comme dans certaines approches en EMDR IMO...
Où le sens vient après, où la compréhension vient après.
Parce que le trauma n’est pas un problème à analyser, mais une charge à libérer.
Et parfois, pour guérir, il suffit d’un point, un minuscule point dans le regard, juste trouvé au bon moment, et accueilli avec la bonne présence...Et tenu jusqu’à ce que la vie recommence enfin à circuler.
Lire l'article dans son intégralité... Commandez le Hors-Série 18 de la Revue Hypnose & Thérapies Brèves sur le Psychotraumatisme en cliquant sur ce lien
Crédit Photo © Xavier Montoy
Elles demandent à être localisées, à être trouvées, quelque part dans l’espace, ou dans un regard qui ne bouge plus.
Dans cet article, Clotilde Hennequin-Rivoire nous parle du Brainspotting comme d’une rencontre silencieuse entre un œil et une mémoire, un peu comme en EMDR et EMDR - IMO...
Une rencontre où le thérapeute n’impose rien, ne dirige rien, ne guérit rien. il trouve, il attend, il accompagne.
Le reste, c’est le corps qui le fait.
L’œil comme boussole du trauma.
La théorie est simple et presque désarmante de simplicité:
il existe un point dans le champ visuel où le système nerveux révèle spontanément l’endroit exact où le trauma est logé. Un point minuscule. Un angle de regard. Une micro-déviation.
Quelque chose comme un frémissement des paupières, une respiration suspendue, un arrêt du cou, une émotion qui monte d’un coup.
Ce point, le brainspot, est la porte d’accès à la charge traumatique.
David Grand, qui l’a découvert presque par accident, nous dit que le cerveau “parle” à travers le regard, qu’il montre où il a été blessé, où il s’est figé, où il attend réparation.
Clotilde Hennequin-Rivoire, quant à elle, en témoigne avec la précision d’une clinicienne et la sensibilité d’une poète.
Quand les mots ne suffisent plus.
Les patients arrivent avec des histoires lourdes : des agressions, des violences familiales, des accidents, des humiliations, des traumas complexes, des émotions incohérentes, des souvenirs fragmentés.
Parfois ils ne savent même pas pourquoi ils vont mal. Ils sentent juste que quelque chose les tire vers le bas.
Alors elle leur demande de suivre un mouvement lent, imperceptible de sa main, ou parfois un simple stylo, jusqu’à ce que quelque chose accroche: une pupille qui se bloque , un souffle qui change, ene larme qui se forme, un frisson, un effondrement ou même un sourire brutal.
Là, dans cette minuscule rencontre oculaire, quelque chose s’ouvre.
Rester là où ça tremble.
Le travail du Brainspotting est d’une simplicité déroutante :
on reste, on ne bouge pas, on maintient le regard, on laisse l’émotion prendre sa place, on permet au système nerveux de réorganiser ce qu’il avait figé.
Le thérapeute ne commente pas, ni ne dirige et ne reformule pas.
Il contient, tout simplement. Il offre la présence stable que l’enfant blessé n’a jamais eue, la présence ferme que l’adulte traumatisé ne trouve plus.
Et les patients peuvent explorent alors :
des tremblements, des vagues de chaleur, des tensions cervicales, des souvenirs flous, des images brèves, des sensations archaïques.
Et parfois, rien ne vient...
Mais “rien” en Brainspotting est déjà une information : c'est alors que le système se réorganise en profondeur, en silence.
Quand la charge se dissout.
Un moment arrive, toujours différent, où le corps fait un mouvement spontané : une expiration plus longue, un relâchement des épaules, une bascule de tête, un micro-sourire.
Bref, la charge traumatique se défait.
Sans qu’on ait eu besoin de la raconter, sans qu’on l’ait disséquée, sans qu’on ait même compris.
Le cerveau, livré à lui-même, va retrouver son chemin de réparation.
Le regard comme ancrage du monde intérieur.
Ce qu’Hennequin-Rivoire raconte avec le plus de délicatesse, c’est ce geste final : quand le patient détourne enfin les yeux, c’est comme si le monde revenait tout entier, le regard redevient mobile le présent redevient accessible, la connexion à soi circule de nouveau.
Le Brainspotting est donc une approche où les mots viennent après, un peu comme dans certaines approches en EMDR IMO...
Où le sens vient après, où la compréhension vient après.
Parce que le trauma n’est pas un problème à analyser, mais une charge à libérer.
Et parfois, pour guérir, il suffit d’un point, un minuscule point dans le regard, juste trouvé au bon moment, et accueilli avec la bonne présence...Et tenu jusqu’à ce que la vie recommence enfin à circuler.
Lire l'article dans son intégralité... Commandez le Hors-Série 18 de la Revue Hypnose & Thérapies Brèves sur le Psychotraumatisme en cliquant sur ce lien
Crédit Photo © Xavier Montoy
Catégories: Hypnose Paris,EMDR,Thérapie Brève Paris
Formation EMDR - IMO à Paris - Intégration par les mouvements oculaires
Formation EMDR - IMO à Paris: La formation sur le Psychotraumatisme permet l’apprentissage des mouvements oculaires alternatifs de type EMDR, IMO, leur intégration dans l’hypnose éricksonienne et la focalisation sur les outils efficaces dans un cadre de thérapies brèves. Cette formation est Validée et Certifiée par France EMDR-IMO ®
Pour participer à cette formation, il faut être un professionnel de la santé et du soin et avoir été formé à l’hypnose au CHTIP, à l'Institut In-Dolore, à l’IFH, à Hypnotim (Marseille) ou dans un institut de la CFHTB.
La formation dure 3 jours et inclut de nombreux exercices et démonstrations.
Les prochaines dates :
Du 8 au 10 Décembre 2025
ou du 1 au 3 Juin 2026
Espace Hermès
10 Cité Joly
75011 Paris
Une supervision en EMDR sera donnée à Paris par Laurent GROSS en Janvier 2026 à Paris.
S'inscrire à la formation au Collège d'Hypnose & Thérapies Intégratives de Paris et In-Dolore
Une Masterclass en EMDR sera donnée par Laurent GROSS à Marseille les 21 et 22 Mars 2024
Laurence ADJADJ, Présidente de France EMDR-IMO ®
Présidente de l’institut Hypnotim
Présidente de France EMDR-IMO ®: Association qui édite le Registre des Praticiens et Formations EMDR-IMO de France.
Formatrice et conférencière internationale.
Formatrice en EMDR - IMO à Marseille et Paris
Laurent GROSS, Vice Président de France EMDR-IMO ®
Président du CHTIP Collège d'Hypnose et Thérapies Intégratives de Paris,
Président de l'Institut In-Dolore,
Vice Président de France EMDR-IMO ®
Enseignant au DU de Psychothérapie Intégrative de Strasbourg ainsi qu'à l'AP-HP.
Conférencier International.
Ex-Kinésithérapeute depuis 1984, certifié Psychothérapeute par l'ARS en 2013, Hypnothérapeute, Certificateur EMDR IMO.
Pour participer à cette formation, il faut être un professionnel de la santé et du soin et avoir été formé à l’hypnose au CHTIP, à l'Institut In-Dolore, à l’IFH, à Hypnotim (Marseille) ou dans un institut de la CFHTB.
La formation dure 3 jours et inclut de nombreux exercices et démonstrations.
Les prochaines dates :
Du 8 au 10 Décembre 2025
ou du 1 au 3 Juin 2026
Espace Hermès
10 Cité Joly
75011 Paris
Une supervision en EMDR sera donnée à Paris par Laurent GROSS en Janvier 2026 à Paris.
S'inscrire à la formation au Collège d'Hypnose & Thérapies Intégratives de Paris et In-Dolore
Une Masterclass en EMDR sera donnée par Laurent GROSS à Marseille les 21 et 22 Mars 2024
Laurence ADJADJ, Présidente de France EMDR-IMO ®
Présidente de l’institut Hypnotim
Présidente de France EMDR-IMO ®: Association qui édite le Registre des Praticiens et Formations EMDR-IMO de France.
Formatrice et conférencière internationale.
Formatrice en EMDR - IMO à Marseille et Paris
Laurent GROSS, Vice Président de France EMDR-IMO ®
Président du CHTIP Collège d'Hypnose et Thérapies Intégratives de Paris,
Président de l'Institut In-Dolore,
Vice Président de France EMDR-IMO ®
Enseignant au DU de Psychothérapie Intégrative de Strasbourg ainsi qu'à l'AP-HP.
Conférencier International.
Ex-Kinésithérapeute depuis 1984, certifié Psychothérapeute par l'ARS en 2013, Hypnothérapeute, Certificateur EMDR IMO.
Catégories: Hypnose Paris,EMDR,Thérapie Brève Paris
Formation EMDR - IMO à Paris - Intégration par les mouvements oculaires
Formation EMDR - IMO à Paris: La formation sur le Psychotraumatisme permet l’apprentissage des mouvements oculaires alternatifs de type EMDR, IMO, leur intégration dans l’hypnose éricksonienne et la focalisation sur les outils efficaces dans un cadre de thérapies brèves. Cette formation est Validée et Certifiée par France EMDR-IMO ®
Pour participer à cette formation, il faut être un professionnel de la santé et du soin et avoir été formé à l’hypnose au CHTIP, à l'Institut In-Dolore, à l’IFH, à Hypnotim (Marseille) ou dans un institut de la CFHTB.
La formation dure 3 jours et inclut de nombreux exercices et démonstrations.
Les prochaines dates :
Du 8 au 10 Décembre 2025
ou du 1 au 3 Juin 2026
Espace Hermès
10 Cité Joly
75011 Paris
Une supervision en EMDR sera donnée à Paris par Laurent GROSS en Janvier 2026 à Paris.
S'inscrire à la formation au Collège d'Hypnose & Thérapies Intégratives de Paris et In-Dolore
Une Masterclass en EMDR sera donnée par Laurent GROSS à Marseille les 21 et 22 Mars 2024
Laurence ADJADJ, Présidente de France EMDR-IMO ®
Présidente de l’institut Hypnotim
Présidente de France EMDR-IMO ®: Association qui édite le Registre des Praticiens et Formations EMDR-IMO de France.
Formatrice et conférencière internationale.
Formatrice en EMDR - IMO à Marseille et Paris
Laurent GROSS, Vice Président de France EMDR-IMO ®
Président du CHTIP Collège d'Hypnose et Thérapies Intégratives de Paris,
Président de l'Institut In-Dolore,
Vice Président de France EMDR-IMO ®
Enseignant au DU de Psychothérapie Intégrative de Strasbourg ainsi qu'à l'AP-HP.
Conférencier International.
Ex-Kinésithérapeute depuis 1984, certifié Psychothérapeute par l'ARS en 2013, Hypnothérapeute, Certificateur EMDR IMO.
Pour participer à cette formation, il faut être un professionnel de la santé et du soin et avoir été formé à l’hypnose au CHTIP, à l'Institut In-Dolore, à l’IFH, à Hypnotim (Marseille) ou dans un institut de la CFHTB.
La formation dure 3 jours et inclut de nombreux exercices et démonstrations.
Les prochaines dates :
Du 8 au 10 Décembre 2025
ou du 1 au 3 Juin 2026
Espace Hermès
10 Cité Joly
75011 Paris
Une supervision en EMDR sera donnée à Paris par Laurent GROSS en Janvier 2026 à Paris.
S'inscrire à la formation au Collège d'Hypnose & Thérapies Intégratives de Paris et In-Dolore
Une Masterclass en EMDR sera donnée par Laurent GROSS à Marseille les 21 et 22 Mars 2024
Laurence ADJADJ, Présidente de France EMDR-IMO ®
Présidente de l’institut Hypnotim
Présidente de France EMDR-IMO ®: Association qui édite le Registre des Praticiens et Formations EMDR-IMO de France.
Formatrice et conférencière internationale.
Formatrice en EMDR - IMO à Marseille et Paris
Laurent GROSS, Vice Président de France EMDR-IMO ®
Président du CHTIP Collège d'Hypnose et Thérapies Intégratives de Paris,
Président de l'Institut In-Dolore,
Vice Président de France EMDR-IMO ®
Enseignant au DU de Psychothérapie Intégrative de Strasbourg ainsi qu'à l'AP-HP.
Conférencier International.
Ex-Kinésithérapeute depuis 1984, certifié Psychothérapeute par l'ARS en 2013, Hypnothérapeute, Certificateur EMDR IMO.
Catégories: Hypnose Paris,EMDR,Thérapie Brève Paris
Formations EMDR: le premier comparatif structuré.
France EMDR - IMO ®, dont je suis le Vice Président, a le plaisir d’annoncer, avec une joie non dissimulée, la parution du tableau comparatif des formations EMDR en France. Un document indépendant, clair et structuré… qui met enfin en lumière la diversité du paysage, la qualité des approches, et le sérieux des institutions réellement engagées dans la formation. Nous sommes particulièrement heureux d’y voir reconnue l’approche EMDR Intégrative, portée par des professionnels de santé et fondée sur des bases scientifiques solides.
Depuis longtemps, les professionnels de la psychothérapie, les hypnothérapeutes attendaient un panorama fiable des formations EMDR disponibles en France. Ce travail de comparaison offre enfin une vision structurée et lisible d’un univers où s’entremêlent une multitude de méthodes, d’intitulés et d’écoles, parfois au point de perdre les praticiens les plus aguerris.
Comme dans le milieu de l’hypnose, l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) s’est développée à travers des organismes très sérieux… et d’autres beaucoup plus discutables, hélas.
Face aux approches validées cohabitent des déclinaisons parallèles, des adaptations personnelles ou des versions simplifiées dont les noms remplissent à eux seuls des pages entières : DMOKA ®, DNR ®, EMDR-AC ®, EMDR-DSA ®, EMDR - IMO ®, EMDR-RSB ®, EMDR-DMO ®, EMDR-PE.PS ®, RITMO ®, Thérapie MOSAIC ®, ou encore IMO (Intégration par les Mouvements Oculaires). Un véritable foisonnement qui rendait urgent un outil de comparaison impartial.
Chaque sigle renvoie d’ailleurs à une vision particulière de l’accompagnement thérapeutique : certaines restent proches du modèle élaboré par Francine Shapiro, d’autres en prennent des libertés plus ou moins assumées.
Le tableau met ainsi en lumière les différences essentielles : nature du protocole, qualité pédagogique, et surtout compétences réelles en santé mentale des équipes enseignantes. Un critère déterminant pour garantir une formation solide.
Ce panorama recense les acteurs incontournables du territoire : ACCH, AFPRA, AHTMA, CAP au 180, CHTIP – Collège d’Hypnose et Thérapies Intégratives de Paris, EDEPHE, EMDR France, France EMDR-IMO, EPSYLONE, HARMONESIS, HYPNOSALYS, IFEMDR, Institut Hypnotim Marseille, Institut IN-DOLORE, PÔLE EMDR, PSYNAPSE, SENSALYS, SYMBIOFI et IPNOSIA.
A partir des instituts de base EMDR France, certaines structures se démarquent par une orientation clairement intégrative de l’EMDR. C’est le cas de France EMDR-IMO (dont je suis Vice Président, et fier aussi d'avoir été si bien classé), qui s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes) et propose une lecture élargie des mouvements oculaires, combinant neurosciences, hypnose et communication thérapeutique. Une approche connue sous le nom d’EMDR Intégrative, pensée pour replacer la personne au centre du processus thérapeutique.
Plus qu’un simple tableau comparatif, ce document offre une clarification indispensable dans un secteur en plein essor. Il rappelle que la qualité d’une formation conditionne directement la qualité de l’accompagnement proposé aux patients. Pour les praticiens comme pour les professionnels de santé en recherche d’une formation, il représente une étape importante : celle d’un regard enfin structuré et éclairé sur l’ensemble des pratiques EMDR en France.
Accédez au tableau complet des formations en cliquant ici…
Comme dans le milieu de l’hypnose, l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) s’est développée à travers des organismes très sérieux… et d’autres beaucoup plus discutables, hélas.
Face aux approches validées cohabitent des déclinaisons parallèles, des adaptations personnelles ou des versions simplifiées dont les noms remplissent à eux seuls des pages entières : DMOKA ®, DNR ®, EMDR-AC ®, EMDR-DSA ®, EMDR - IMO ®, EMDR-RSB ®, EMDR-DMO ®, EMDR-PE.PS ®, RITMO ®, Thérapie MOSAIC ®, ou encore IMO (Intégration par les Mouvements Oculaires). Un véritable foisonnement qui rendait urgent un outil de comparaison impartial.
Chaque sigle renvoie d’ailleurs à une vision particulière de l’accompagnement thérapeutique : certaines restent proches du modèle élaboré par Francine Shapiro, d’autres en prennent des libertés plus ou moins assumées.
Le tableau met ainsi en lumière les différences essentielles : nature du protocole, qualité pédagogique, et surtout compétences réelles en santé mentale des équipes enseignantes. Un critère déterminant pour garantir une formation solide.
Ce panorama recense les acteurs incontournables du territoire : ACCH, AFPRA, AHTMA, CAP au 180, CHTIP – Collège d’Hypnose et Thérapies Intégratives de Paris, EDEPHE, EMDR France, France EMDR-IMO, EPSYLONE, HARMONESIS, HYPNOSALYS, IFEMDR, Institut Hypnotim Marseille, Institut IN-DOLORE, PÔLE EMDR, PSYNAPSE, SENSALYS, SYMBIOFI et IPNOSIA.
A partir des instituts de base EMDR France, certaines structures se démarquent par une orientation clairement intégrative de l’EMDR. C’est le cas de France EMDR-IMO (dont je suis Vice Président, et fier aussi d'avoir été si bien classé), qui s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes) et propose une lecture élargie des mouvements oculaires, combinant neurosciences, hypnose et communication thérapeutique. Une approche connue sous le nom d’EMDR Intégrative, pensée pour replacer la personne au centre du processus thérapeutique.
Plus qu’un simple tableau comparatif, ce document offre une clarification indispensable dans un secteur en plein essor. Il rappelle que la qualité d’une formation conditionne directement la qualité de l’accompagnement proposé aux patients. Pour les praticiens comme pour les professionnels de santé en recherche d’une formation, il représente une étape importante : celle d’un regard enfin structuré et éclairé sur l’ensemble des pratiques EMDR en France.
Accédez au tableau complet des formations en cliquant ici…
Catégories: Hypnose Paris,EMDR,Thérapie Brève Paris
Formations EMDR: le premier comparatif structuré.
France EMDR - IMO ®, dont je suis le Vice Président, a le plaisir d’annoncer, avec une joie non dissimulée, la parution du tableau comparatif des formations EMDR en France. Un document indépendant, clair et structuré… qui met enfin en lumière la diversité du paysage, la qualité des approches, et le sérieux des institutions réellement engagées dans la formation. Nous sommes particulièrement heureux d’y voir reconnue l’approche EMDR Intégrative, portée par des professionnels de santé et fondée sur des bases scientifiques solides.
Depuis longtemps, les professionnels de la psychothérapie, les hypnothérapeutes attendaient un panorama fiable des formations EMDR disponibles en France. Ce travail de comparaison offre enfin une vision structurée et lisible d’un univers où s’entremêlent une multitude de méthodes, d’intitulés et d’écoles, parfois au point de perdre les praticiens les plus aguerris.
Comme dans le milieu de l’hypnose, l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) s’est développée à travers des organismes très sérieux… et d’autres beaucoup plus discutables, hélas.
Face aux approches validées cohabitent des déclinaisons parallèles, des adaptations personnelles ou des versions simplifiées dont les noms remplissent à eux seuls des pages entières : DMOKA ®, DNR ®, EMDR-AC ®, EMDR-DSA ®, EMDR - IMO ®, EMDR-RSB ®, EMDR-DMO ®, EMDR-PE.PS ®, RITMO ®, Thérapie MOSAIC ®, ou encore IMO (Intégration par les Mouvements Oculaires). Un véritable foisonnement qui rendait urgent un outil de comparaison impartial.
Chaque sigle renvoie d’ailleurs à une vision particulière de l’accompagnement thérapeutique : certaines restent proches du modèle élaboré par Francine Shapiro, d’autres en prennent des libertés plus ou moins assumées.
Le tableau met ainsi en lumière les différences essentielles : nature du protocole, qualité pédagogique, et surtout compétences réelles en santé mentale des équipes enseignantes. Un critère déterminant pour garantir une formation solide.
Ce panorama recense les acteurs incontournables du territoire : ACCH, AFPRA, AHTMA, CAP au 180, CHTIP – Collège d’Hypnose et Thérapies Intégratives de Paris, EDEPHE, EMDR France, France EMDR-IMO, EPSYLONE, HARMONESIS, HYPNOSALYS, IFEMDR, Institut Hypnotim Marseille, Institut IN-DOLORE, PÔLE EMDR, PSYNAPSE, SENSALYS, SYMBIOFI et IPNOSIA.
A partir des instituts de base EMDR France, certaines structures se démarquent par une orientation clairement intégrative de l’EMDR. C’est le cas de France EMDR-IMO (dont je suis Vice Président, et fier aussi d'avoir été si bien classé), qui s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes) et propose une lecture élargie des mouvements oculaires, combinant neurosciences, hypnose et communication thérapeutique. Une approche connue sous le nom d’EMDR Intégrative, pensée pour replacer la personne au centre du processus thérapeutique.
Plus qu’un simple tableau comparatif, ce document offre une clarification indispensable dans un secteur en plein essor. Il rappelle que la qualité d’une formation conditionne directement la qualité de l’accompagnement proposé aux patients. Pour les praticiens comme pour les professionnels de santé en recherche d’une formation, il représente une étape importante : celle d’un regard enfin structuré et éclairé sur l’ensemble des pratiques EMDR en France.
Accédez au tableau complet des formations en cliquant ici…
Comme dans le milieu de l’hypnose, l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) s’est développée à travers des organismes très sérieux… et d’autres beaucoup plus discutables, hélas.
Face aux approches validées cohabitent des déclinaisons parallèles, des adaptations personnelles ou des versions simplifiées dont les noms remplissent à eux seuls des pages entières : DMOKA ®, DNR ®, EMDR-AC ®, EMDR-DSA ®, EMDR - IMO ®, EMDR-RSB ®, EMDR-DMO ®, EMDR-PE.PS ®, RITMO ®, Thérapie MOSAIC ®, ou encore IMO (Intégration par les Mouvements Oculaires). Un véritable foisonnement qui rendait urgent un outil de comparaison impartial.
Chaque sigle renvoie d’ailleurs à une vision particulière de l’accompagnement thérapeutique : certaines restent proches du modèle élaboré par Francine Shapiro, d’autres en prennent des libertés plus ou moins assumées.
Le tableau met ainsi en lumière les différences essentielles : nature du protocole, qualité pédagogique, et surtout compétences réelles en santé mentale des équipes enseignantes. Un critère déterminant pour garantir une formation solide.
Ce panorama recense les acteurs incontournables du territoire : ACCH, AFPRA, AHTMA, CAP au 180, CHTIP – Collège d’Hypnose et Thérapies Intégratives de Paris, EDEPHE, EMDR France, France EMDR-IMO, EPSYLONE, HARMONESIS, HYPNOSALYS, IFEMDR, Institut Hypnotim Marseille, Institut IN-DOLORE, PÔLE EMDR, PSYNAPSE, SENSALYS, SYMBIOFI et IPNOSIA.
A partir des instituts de base EMDR France, certaines structures se démarquent par une orientation clairement intégrative de l’EMDR. C’est le cas de France EMDR-IMO (dont je suis Vice Président, et fier aussi d'avoir été si bien classé), qui s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes) et propose une lecture élargie des mouvements oculaires, combinant neurosciences, hypnose et communication thérapeutique. Une approche connue sous le nom d’EMDR Intégrative, pensée pour replacer la personne au centre du processus thérapeutique.
Plus qu’un simple tableau comparatif, ce document offre une clarification indispensable dans un secteur en plein essor. Il rappelle que la qualité d’une formation conditionne directement la qualité de l’accompagnement proposé aux patients. Pour les praticiens comme pour les professionnels de santé en recherche d’une formation, il représente une étape importante : celle d’un regard enfin structuré et éclairé sur l’ensemble des pratiques EMDR en France.
Accédez au tableau complet des formations en cliquant ici…
Catégories: Hypnose Paris,EMDR,Thérapie Brève Paris
Un Livre Blanc pour enfin y voir clair dans la jungle des formations EMDR : fini les sigles farfelus et les techniques « exotiques » !
Dans un paysage où les thérapies centrées sur les traumatismes connaissent un essor fulgurant, un document de référence vient enfin remettre de l’ordre : Le Livre Blanc des Formations EMDR en France. En réaffirmant l’importance de la qualité pédagogique, scientifique et clinique, ce guide offre aux professionnels, aux étudiants et aux patients un éclairage clair et indépendant sur les formations réellement sérieuses en EMDR Intégrative.
Alors, pourquoi ce Livre Blanc ? - Parce que choisir une formation en EMDR relève souvent « d’un véritable parcours du combattant ».
Les offres se multiplient, mais pas toujours pour les bonnes raisons : aux côtés des approches fondées et rigoureuses, l’on voit fleurir des déclinaisons maison comme DNR ®, DMOKA ®, DMO ®, RSB ®, DSA ®, PEPS ®, RITMO ® ou encore PIPO, souvent plus proches de réinventions marketing que d’une véritable approche psychothérapeutique.
Ces variantes, parfois séduisantes par leur nom ou leur promesse d’efficacité « augmentée », manquent le plus souvent d’assises scientifiques solides et entretiennent la confusion.
- Parce que pour un futur patient, connaître l’origine et la qualité de la formation de son thérapeute est un enjeu essentiel de confiance et de sécurité.
Avec l’apparition de méthodes parallèles qui empruntent au vocabulaire de l’EMDR sans en respecter la structure ou les fondements, ce besoin de transparence n’a jamais été aussi crucial.
- Parce que les formations sont nombreuses, hétérogènes, et que les repères fiables se faisaient jusqu’alors rares.
Ce que propose ce tableau comparatif. Une cartographie détaillée des 24 principaux centres de formation en EMDR en France, présentés dans un tableau clair et lisible.
Contrairement aux approches dérivées telles que DNR, DMOKA, DMO ou PEPS, souvent absentes de toute validation universitaire, le Livre Blanc met en lumière ceux qui s’appuient sur des bases théoriques et cliniques solides.
L’introduction de l’Indice de ROCHMA, un outil de notation permettant de comparer objectivement les formations selon quatre critères majeurs :
- reconnaissance des formateurs en santé mentale,
- public visé (professionnels de santé ou « tout venant »),
- adossement universitaire réel,
- modalités de supervision après la formation.
Cet indice met naturellement en évidence les écarts entre les formations construites sur des fondements psychothérapeutiques sérieux… et les approches périphériques dont l’habillage change mais dont les garanties demeurent minces.
Alors, ce tableau représente réellement une aide concrète pour : - les praticiens ou futurs praticiens souhaitant s’engager dans une formation EMDR reconnue, rigoureuse et complète,
- les patients et usagers désirant vérifier la qualité de la formation de leur thérapeute afin d’éviter les alternatives « colorées », « remixées » ou simplement non fondées qui s’éloignent de l’EMDR validée.
Accédez au Livre Blanc des Formations EMDR
Alors, pourquoi ce Livre Blanc ? - Parce que choisir une formation en EMDR relève souvent « d’un véritable parcours du combattant ».
Les offres se multiplient, mais pas toujours pour les bonnes raisons : aux côtés des approches fondées et rigoureuses, l’on voit fleurir des déclinaisons maison comme DNR ®, DMOKA ®, DMO ®, RSB ®, DSA ®, PEPS ®, RITMO ® ou encore PIPO, souvent plus proches de réinventions marketing que d’une véritable approche psychothérapeutique.
Ces variantes, parfois séduisantes par leur nom ou leur promesse d’efficacité « augmentée », manquent le plus souvent d’assises scientifiques solides et entretiennent la confusion.
- Parce que pour un futur patient, connaître l’origine et la qualité de la formation de son thérapeute est un enjeu essentiel de confiance et de sécurité.
Avec l’apparition de méthodes parallèles qui empruntent au vocabulaire de l’EMDR sans en respecter la structure ou les fondements, ce besoin de transparence n’a jamais été aussi crucial.
- Parce que les formations sont nombreuses, hétérogènes, et que les repères fiables se faisaient jusqu’alors rares.
Ce que propose ce tableau comparatif. Une cartographie détaillée des 24 principaux centres de formation en EMDR en France, présentés dans un tableau clair et lisible.
Contrairement aux approches dérivées telles que DNR, DMOKA, DMO ou PEPS, souvent absentes de toute validation universitaire, le Livre Blanc met en lumière ceux qui s’appuient sur des bases théoriques et cliniques solides.
L’introduction de l’Indice de ROCHMA, un outil de notation permettant de comparer objectivement les formations selon quatre critères majeurs :
- reconnaissance des formateurs en santé mentale,
- public visé (professionnels de santé ou « tout venant »),
- adossement universitaire réel,
- modalités de supervision après la formation.
Cet indice met naturellement en évidence les écarts entre les formations construites sur des fondements psychothérapeutiques sérieux… et les approches périphériques dont l’habillage change mais dont les garanties demeurent minces.
Alors, ce tableau représente réellement une aide concrète pour : - les praticiens ou futurs praticiens souhaitant s’engager dans une formation EMDR reconnue, rigoureuse et complète,
- les patients et usagers désirant vérifier la qualité de la formation de leur thérapeute afin d’éviter les alternatives « colorées », « remixées » ou simplement non fondées qui s’éloignent de l’EMDR validée.
Accédez au Livre Blanc des Formations EMDR
Catégories: Hypnose Paris,EMDR,Thérapie Brève Paris
Un Livre Blanc pour enfin y voir clair dans la jungle des formations EMDR : fini les sigles farfelus et les techniques « exotiques » !
Dans un paysage où les thérapies centrées sur les traumatismes connaissent un essor fulgurant, un document de référence vient enfin remettre de l’ordre : Le Livre Blanc des Formations EMDR en France. En réaffirmant l’importance de la qualité pédagogique, scientifique et clinique, ce guide offre aux professionnels, aux étudiants et aux patients un éclairage clair et indépendant sur les formations réellement sérieuses en EMDR Intégrative.
Alors, pourquoi ce Livre Blanc ? - Parce que choisir une formation en EMDR relève souvent « d’un véritable parcours du combattant ».
Les offres se multiplient, mais pas toujours pour les bonnes raisons : aux côtés des approches fondées et rigoureuses, l’on voit fleurir des déclinaisons maison comme DNR ®, DMOKA ®, DMO ®, RSB ®, DSA ®, PEPS ®, RITMO ® ou encore PIPO, souvent plus proches de réinventions marketing que d’une véritable approche psychothérapeutique.
Ces variantes, parfois séduisantes par leur nom ou leur promesse d’efficacité « augmentée », manquent le plus souvent d’assises scientifiques solides et entretiennent la confusion.
- Parce que pour un futur patient, connaître l’origine et la qualité de la formation de son thérapeute est un enjeu essentiel de confiance et de sécurité.
Avec l’apparition de méthodes parallèles qui empruntent au vocabulaire de l’EMDR sans en respecter la structure ou les fondements, ce besoin de transparence n’a jamais été aussi crucial.
- Parce que les formations sont nombreuses, hétérogènes, et que les repères fiables se faisaient jusqu’alors rares.
Ce que propose ce tableau comparatif. Une cartographie détaillée des 24 principaux centres de formation en EMDR en France, présentés dans un tableau clair et lisible.
Contrairement aux approches dérivées telles que DNR, DMOKA, DMO ou PEPS, souvent absentes de toute validation universitaire, le Livre Blanc met en lumière ceux qui s’appuient sur des bases théoriques et cliniques solides.
L’introduction de l’Indice de ROCHMA, un outil de notation permettant de comparer objectivement les formations selon quatre critères majeurs :
- reconnaissance des formateurs en santé mentale,
- public visé (professionnels de santé ou « tout venant »),
- adossement universitaire réel,
- modalités de supervision après la formation.
Cet indice met naturellement en évidence les écarts entre les formations construites sur des fondements psychothérapeutiques sérieux… et les approches périphériques dont l’habillage change mais dont les garanties demeurent minces.
Alors, ce tableau représente réellement une aide concrète pour : - les praticiens ou futurs praticiens souhaitant s’engager dans une formation EMDR reconnue, rigoureuse et complète,
- les patients et usagers désirant vérifier la qualité de la formation de leur thérapeute afin d’éviter les alternatives « colorées », « remixées » ou simplement non fondées qui s’éloignent de l’EMDR validée.
Accédez au Livre Blanc des Formations EMDR
Alors, pourquoi ce Livre Blanc ? - Parce que choisir une formation en EMDR relève souvent « d’un véritable parcours du combattant ».
Les offres se multiplient, mais pas toujours pour les bonnes raisons : aux côtés des approches fondées et rigoureuses, l’on voit fleurir des déclinaisons maison comme DNR ®, DMOKA ®, DMO ®, RSB ®, DSA ®, PEPS ®, RITMO ® ou encore PIPO, souvent plus proches de réinventions marketing que d’une véritable approche psychothérapeutique.
Ces variantes, parfois séduisantes par leur nom ou leur promesse d’efficacité « augmentée », manquent le plus souvent d’assises scientifiques solides et entretiennent la confusion.
- Parce que pour un futur patient, connaître l’origine et la qualité de la formation de son thérapeute est un enjeu essentiel de confiance et de sécurité.
Avec l’apparition de méthodes parallèles qui empruntent au vocabulaire de l’EMDR sans en respecter la structure ou les fondements, ce besoin de transparence n’a jamais été aussi crucial.
- Parce que les formations sont nombreuses, hétérogènes, et que les repères fiables se faisaient jusqu’alors rares.
Ce que propose ce tableau comparatif. Une cartographie détaillée des 24 principaux centres de formation en EMDR en France, présentés dans un tableau clair et lisible.
Contrairement aux approches dérivées telles que DNR, DMOKA, DMO ou PEPS, souvent absentes de toute validation universitaire, le Livre Blanc met en lumière ceux qui s’appuient sur des bases théoriques et cliniques solides.
L’introduction de l’Indice de ROCHMA, un outil de notation permettant de comparer objectivement les formations selon quatre critères majeurs :
- reconnaissance des formateurs en santé mentale,
- public visé (professionnels de santé ou « tout venant »),
- adossement universitaire réel,
- modalités de supervision après la formation.
Cet indice met naturellement en évidence les écarts entre les formations construites sur des fondements psychothérapeutiques sérieux… et les approches périphériques dont l’habillage change mais dont les garanties demeurent minces.
Alors, ce tableau représente réellement une aide concrète pour : - les praticiens ou futurs praticiens souhaitant s’engager dans une formation EMDR reconnue, rigoureuse et complète,
- les patients et usagers désirant vérifier la qualité de la formation de leur thérapeute afin d’éviter les alternatives « colorées », « remixées » ou simplement non fondées qui s’éloignent de l’EMDR validée.
Accédez au Livre Blanc des Formations EMDR
Catégories: Hypnose Paris,EMDR,Thérapie Brève Paris